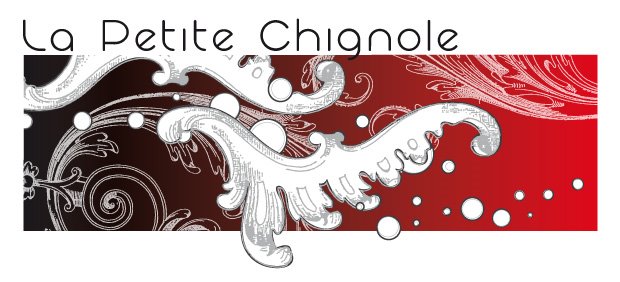Finitions
 La finition de la guitare se fait différemment dans un premier temps pour la partie bois et la partie galuchat. Alors que le bois est poncé au papier de verre, le galuchat, en dentine et émail, est dégrossi à la lime. Une fois le galuchat poncé, en respectant l'homogénéité du grain, le tout est repris pour apporter une finition extrêmement douce au touché.
La finition de la guitare se fait différemment dans un premier temps pour la partie bois et la partie galuchat. Alors que le bois est poncé au papier de verre, le galuchat, en dentine et émail, est dégrossi à la lime. Une fois le galuchat poncé, en respectant l'homogénéité du grain, le tout est repris pour apporter une finition extrêmement douce au touché.
Le bois est passé à l'eau chaude entre chaque ponçage pour relever les fibres du bois et atteindre une finition idéale. Il faut cependant faire très attention à ne pas déposer le tanin de l'ébène ainsi que la teinture du galuchat sur le bois clair!
Derniers entaillages
 L'entaillage du galuchat dans une zone restreinte proscrit la scie à placage et ne laisse pour seul choix que d'utiliser un ciseau à bois... Après cette étape je n'aurais plus qu'à réaffûter mon outil!
L'entaillage du galuchat dans une zone restreinte proscrit la scie à placage et ne laisse pour seul choix que d'utiliser un ciseau à bois... Après cette étape je n'aurais plus qu'à réaffûter mon outil!
La première entaille est celle de l'emplacement du manche. Cette étape est délicate et déterminante pour la suite de la fabrication car son positionnement détermine aussi celles des cordes. Un léger angle est donné au talon du manche afin d'améliorer le renversement nécessaire au bon fonctionnement de l'instrument.
L'entaille de la cage d'électronique est effectuée à l'aide du même compas utilisé pour les frisages de la table et du manche. Le galuchat sera réutilisé pour la plaque de la cage.
Collage des peaux sur la table

 Pour le collage des peaux sur la table, des sacs de lin remplis de sable de Fontainebleau servent parfaitement de cale de forme pour le serrage.
Pour le collage des peaux sur la table, des sacs de lin remplis de sable de Fontainebleau servent parfaitement de cale de forme pour le serrage.
Les frisages de la table sont collés dans le même temps pour éviter les déformations et assurer une bonne stabilité du bois. Les chants sont eux composés de neuf parties de galuchat. Ils sont fixés et ajusté un à un.
Les éléments déjà collés sont protégés avec du "tesa" pour minimiser les risques de coulure de la colle. Les résidus entre les grains sont nettoyer à l'aide d'une pointe à tracer.
Percée du truss rod
 Cette étape est le moment de redécouvrir le truss rod que l'on avait laissé emprisonné tout ce temps entre la touche et le manche. Une percée est faite à l'endroit exact où il débouche, d'où l'importance d'avoir bien pris les cotes précises de son emplacement. Une fois le truss rod libéré, un petit carré d'ébène est rajouté afin de bien encadrer son entrée sans en fragiliser sa structure.
Cette étape est le moment de redécouvrir le truss rod que l'on avait laissé emprisonné tout ce temps entre la touche et le manche. Une percée est faite à l'endroit exact où il débouche, d'où l'importance d'avoir bien pris les cotes précises de son emplacement. Une fois le truss rod libéré, un petit carré d'ébène est rajouté afin de bien encadrer son entrée sans en fragiliser sa structure.
La pente créée avec une gouge sur la touche s'aligne sur une courbe du frisage de la table.
Incrustation de la tête de manche

 La tête de la basse est gaînée de galuchat sur ses deux faces. Le devant possède une épine dorsale ainsi qu'une marqueterie en ébène. "Kame", ma signature, est la contraction du mot "Kairage-Zame" (Kame), galuchat en japonais. La peau de derrière reste plus épurée et va dans le prolongement du frisage de la bande dorsale du manche.
La tête de la basse est gaînée de galuchat sur ses deux faces. Le devant possède une épine dorsale ainsi qu'une marqueterie en ébène. "Kame", ma signature, est la contraction du mot "Kairage-Zame" (Kame), galuchat en japonais. La peau de derrière reste plus épurée et va dans le prolongement du frisage de la bande dorsale du manche.
La peau est découpée avec une scie à marqueterie et l'incrustation est faite avec une gouge et une défonceuse.
Le plateau

• Plateau •
Le plateau, gainé, est constitué d'une planche de contre-plaqué embrevée, à l'aide de fausses languettes, aux emboîtures en acajou. Celles-ci, coupées à 45°, sont assemblées à faux tenons, entièrement replaquées d'une frise en wengue (en travers); et feuillurées, afin de recevoir une baguette "carré" en amarante reconstituée (superposition de placage). Le plateau, moins épais que les emboîtures, permet d'accueillir le cuir.
Les tiroirs


• Tiroir •
Ce bureau possède une ceinture ouvrant à trois tiroirs, dont un central plus fin; en hêtre pour les parois et acajou alaisé en amarante pour les façades. Les tiroirs sont assemblés à queues-d'aronde et leur fermeture est assurée par une serrure à entailler en laiton. Les fonds, en contre-plaqué, préplaqués en sycomore, rentrent en rainure dans les parois de côtés et la façade de tiroir, et sont vissés à la paroi arrière.
Dans chaque tiroir de rives, se cache un coffre. Les parois intermédiaires des tiroirs, en hêtre plaqué amarante, jouant aussi le rôle de façade des coffres, est maintenue par trois tenons borgnes dans les parois de côtés. Leur abbattant, se fermant à l'aide d'une serrure à auberonnière et reposant sur la paroi intermédiaire, est plaqué et alaisé en amarante. Il s'ouvre grâce à deux charnières en laiton coulé.

Le bâti
 • Bâti •
• Bâti •
Ce bureau plat Louis XVI, entièrement replaqué en wengue et amarante, possède un bâti en acajou massif pour les pieds et la façade, et du contre-plaqué pour toutes les parois. La façade du meuble comporte une traverse haute assemblées à doubles tenons dans les montants et les pieds. Ces deux montants, qui séparent les trois tiroirs, sont aussi assemblés à doubles tenons dans la traverse haute.
La paroi de derrière et celles de côtés sont assemblées à fausses languettes dans les têtes de pieds. Les parois intermédiaires sont montées avec des tourillons à l'arrière et des fausses languettes sur les montants de la façade. Les coulisseaux des tiroirs sont collés contre les côtés. Les trois fonds en contreplaqué, préplaqués en sycomore, rentrent dans les rainures des coulisseaux bas et les traverses basses de la façade. Des sabots Louis XVI sont entaillés et vissés dans les pieds.
Le placage
 Voici notre premier projet en ébénisterie! Beaucoup de photos du résultat et peu
Voici notre premier projet en ébénisterie! Beaucoup de photos du résultat et peu
de la fabrication malheureusement...
A l'origine ce bureau est en acajou, n'a pas de serrures ni de coffrets "cachés". Nous l'avons voulu plus élégant et l'avons entièrement replaqué.
Voici quelques explications techniques!
• Placage •
Ce bureau, sur pieds en gaine, est plaqué en ceinture d'un frisage en fougère en amarante, bordé d'un filet en bois de rose, poirier teinté noir et buis, et encadré d'une frise en amarante. Les têtes de pied sont incrustées de la même association d'essence de bois et accueillent sur son pourtour un astragale carré en amarante.
Incrustation de la bande dorsale
 L'incrustation de la bande de galuchat du manche ne fut pas chose aisée... Il nous a fallu définir un profil de manche au préalable et en déduire l'incrustation du galuchat avant que le manche ne soit mis en forme. Cela nous a permis de nous appuyer sur un guide afin de réaliser une entaille précise et constante. Le deuxième "avantage" étant que le manche pourra être mis en forme en même temps que la bande de galuchat, celui-ci ne laissant que très peu de marge d'erreur avant d'attaquer la perse de la peau. Un racloir en forme a été sculpté pour l'occasion.
L'incrustation de la bande de galuchat du manche ne fut pas chose aisée... Il nous a fallu définir un profil de manche au préalable et en déduire l'incrustation du galuchat avant que le manche ne soit mis en forme. Cela nous a permis de nous appuyer sur un guide afin de réaliser une entaille précise et constante. Le deuxième "avantage" étant que le manche pourra être mis en forme en même temps que la bande de galuchat, celui-ci ne laissant que très peu de marge d'erreur avant d'attaquer la perse de la peau. Un racloir en forme a été sculpté pour l'occasion.
La bande de galuchat, en trois parties, est découpée et assemblée suivant les mêmes techniques que le frisage de la table.
Echancrage des chants
 La table est râpée pour être légèrement galbée des deux cotés. Une première face est déjà façonnée, la deuxième est conservée temporairement plane pour laisser un chant de référence. Le chant est ensuite strié avec un tarabiscot sur plusieurs lignes pour faciliter l'échancrage. Le reste est évidé au ciseau à bois et le fond nettoyé à l'aide d'une râpe coudée.
La table est râpée pour être légèrement galbée des deux cotés. Une première face est déjà façonnée, la deuxième est conservée temporairement plane pour laisser un chant de référence. Le chant est ensuite strié avec un tarabiscot sur plusieurs lignes pour faciliter l'échancrage. Le reste est évidé au ciseau à bois et le fond nettoyé à l'aide d'une râpe coudée.Mise en forme de la table
 Après le chantournage de la table à la scie à ruban, il a fallu s'attarder sur les finitions. Faute de moyens adéquats sur le moment, nous avons du faire travailler notre imagination... Aidé d'un ami nous sommes restés sur une technique peu conventionnelle. Nous avons monté un abrasif sur une scie cloche, fixée sur une perceuse. Le tout est maintenu dans une presse perpendiculairement au plan de travail. Malgré l'approche improvisée de ladite technique, la méthode fonctionne très bien à la seule condition de ne pas trop chauffer la perceuse!
Après le chantournage de la table à la scie à ruban, il a fallu s'attarder sur les finitions. Faute de moyens adéquats sur le moment, nous avons du faire travailler notre imagination... Aidé d'un ami nous sommes restés sur une technique peu conventionnelle. Nous avons monté un abrasif sur une scie cloche, fixée sur une perceuse. Le tout est maintenu dans une presse perpendiculairement au plan de travail. Malgré l'approche improvisée de ladite technique, la méthode fonctionne très bien à la seule condition de ne pas trop chauffer la perceuse!Collage de la touche
 Après dégrossissage du manche, la touche en ébène est collée. Le choix de l'essence de la touche est très important, à plus forte raison lorsque la guitare est une frettless (sans frettes). Même avec des cordes adaptées, à filets plats, leur contact direct use la touche prématurément. Pour prévenir ce problème la touche doit être en bois dur.
Après dégrossissage du manche, la touche en ébène est collée. Le choix de l'essence de la touche est très important, à plus forte raison lorsque la guitare est une frettless (sans frettes). Même avec des cordes adaptées, à filets plats, leur contact direct use la touche prématurément. Pour prévenir ce problème la touche doit être en bois dur.Incrustation du truss rod
 Ce truss rod "double-action" a la particularité très avantageuse d'avoir une action convexe et concave sur le réglage du manche. Afin qu'il ne pose aucun souci de fonctionnement par la suite, il est incrusté avec le maximum de soin et de précision. Complètement emprisonné, il ne bougera pas de son logement, n'entraînera donc aucun bruit parasite et réagira au premier tour de clé. Je l'ai aussi choisi débouchant vers le bas pour éviter de fragiliser la jonction tête et manche, et minimiser les fractures.
Ce truss rod "double-action" a la particularité très avantageuse d'avoir une action convexe et concave sur le réglage du manche. Afin qu'il ne pose aucun souci de fonctionnement par la suite, il est incrusté avec le maximum de soin et de précision. Complètement emprisonné, il ne bougera pas de son logement, n'entraînera donc aucun bruit parasite et réagira au premier tour de clé. Je l'ai aussi choisi débouchant vers le bas pour éviter de fragiliser la jonction tête et manche, et minimiser les fractures.
Autre élément important; bien prendre en note les cotes exacts du truss rod avant de l'emprisonner! cela évite quelques surprises au moment de faire la percée...
Montage du frisage • 2

 Suite du découpage sur le même principe que pour l'axe central, à l'exception de la lame de scie qui est montée non plus sur une scie à placage mais sur une sorte de compas. A noter qu'à l'origine cette étape devait être exécutée par une découpe laser. Pour différentes raisons nous n'avons pas pu nous en servir et avons eu recours au dernier moment au système D.
Suite du découpage sur le même principe que pour l'axe central, à l'exception de la lame de scie qui est montée non plus sur une scie à placage mais sur une sorte de compas. A noter qu'à l'origine cette étape devait être exécutée par une découpe laser. Pour différentes raisons nous n'avons pas pu nous en servir et avons eu recours au dernier moment au système D.
! La poussière de galuchat qui est générée est bien plus nocive que la poussière de bois et peut entraîner cécité et cancer des sinus!
Montage du frisage • 1
 Deuxième partie du découpage... L'axe central des frisages est découpé à l'aide d'une scie à placage monté avec une lame de scie à métaux. Je vous parlais plus tôt de la dureté du galuchat, et bien il m'a fallu remplacer plusieurs fois la lame suite au désaffûtage de celles-ci et surtout aux quelques dents qui ont sautées!
Deuxième partie du découpage... L'axe central des frisages est découpé à l'aide d'une scie à placage monté avec une lame de scie à métaux. Je vous parlais plus tôt de la dureté du galuchat, et bien il m'a fallu remplacer plusieurs fois la lame suite au désaffûtage de celles-ci et surtout aux quelques dents qui ont sautées!
Les deux morceaux sont ensuite réunis momentanément au "tesa" puis encollés sur du tissu.
Pré-découpage du frisage
 Une fois les peaux traitées et teintées, c'est une sorte de partie de puzzle qui commence. Des gabarits papiers sont positionnés en suivant le repère des épines dorsales afin de créer le motif prévu. Le jeu consiste à éviter les pertes inutiles et à répartir les morceaux du frisage en essayant d'associer les teintes. Le "pré-découpage" des morceaux se fait à la scie à marqueterie lames métaux, le plus doucement possible pour éviter les risques de casses et dérapages.
Une fois les peaux traitées et teintées, c'est une sorte de partie de puzzle qui commence. Des gabarits papiers sont positionnés en suivant le repère des épines dorsales afin de créer le motif prévu. Le jeu consiste à éviter les pertes inutiles et à répartir les morceaux du frisage en essayant d'associer les teintes. Le "pré-découpage" des morceaux se fait à la scie à marqueterie lames métaux, le plus doucement possible pour éviter les risques de casses et dérapages.Teinte du galuchat


Le processus de teinte du galuchat est assez complexe et délicat car très imprévisible. Matière naturelle et relativement imperméable, seules certaines teintures prennent à coeur. La teinte en surface est ici proscrite car elle disparaîtrait au moment du ponçage. Il est donc de tradition de placer les peaux dans de longs bains. L'autre élément de surprise est que la teinte peut prendre différemment selon les peaux et ce avec la même référence de teinte. Je me suis donc retrouvé avec une sorte de camaïeu de peaux qu'il a fallu assortir au moment du frisage. Les peaux sont teintées avant leur usinage mais après leur préparation.
Cale de radius
 Petit échauffement avec la fabrication d'une cale de radius et bonne exercice de mise en forme avant d'entreprendre la guitare. Le radius, qui est la mesure de la courbure de la touche, n'est pas le même suivant la marque et le type de guitare. Cette cale servira donc à mettre en forme la touche en ébène avec un radius là encore très personnel. Plus prononcé, il se rapprochera plus de celui d'une contrebasse. Au final cela me fait deux cales; cale et contre-cale.
Petit échauffement avec la fabrication d'une cale de radius et bonne exercice de mise en forme avant d'entreprendre la guitare. Le radius, qui est la mesure de la courbure de la touche, n'est pas le même suivant la marque et le type de guitare. Cette cale servira donc à mettre en forme la touche en ébène avec un radius là encore très personnel. Plus prononcé, il se rapprochera plus de celui d'une contrebasse. Au final cela me fait deux cales; cale et contre-cale.Longues méditations....
 Et voilà c'est parti!
Et voilà c'est parti!
Après de longues méditations sous l'emprise du café et en possession de conseils avisés "soutirés", je peux désormais entreprendre cette fabrication de basse au design très personnel.
Une fois les plans achevés, le nombre de peaux nécessaires pour composer le motif de la basse est de douze.
Cela peut paraître impressionnant et excessif, mais le motif unique du galuchat, l'épine dorsale, nécessite souvent plusieurs peaux dans les frisages ou marqueteries.
Il existe quasi autant de formats de galuchats que de tailles de raies. Ainsi les plus grandes peaux peuvent atteindre 500 mm de large. Ici le calibre choisi est de 8 pouces soit 203,2 mm de large. Le grain, proportionnel, est donc beaucoup plus petit et élégant à mon goût.
Première guitare, et premières difficultés en perspectives... dur, dur...
Particularité...

Petite particularité du galuchat.... Ce "cuir" est en réalité composé d'émail et de dentine, ce qui en fait une matière extrêmement résistante. Ces peaux sont donc travaillées, lorsqu'elles ne sont pas tannées, avec des outils adaptés aux métaux. L'utilisation de ciseaux à bois est donc exceptionnelle car elle endommage fortement le fer...
Inscription à :
Commentaires (Atom)